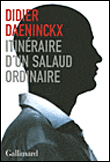
J'ai terminé hier ma lecture de "Itinéraire d'un salaud ordinaire", de Didier Daeninckx. Enfin? Je dois dire que cette lecture m'a laissé perplexe,
plein de pas mal d'interrogations dont je vous fais part dans le présent billet.
Rappelons rapidement la trame de l'histoire: Clément Duprest, brillant étudiant en droit, entre dans la police sous l'Occupation, et se fait le fidèle servant de l'occupant. Quelques bons appuis
lui permettent de faire oublier sa nature de collabo après la guerre; il se retrouve donc à lutter contre les communistes, contre la décolonisation et ses agents, contre Mai 68 et, enfin, contre
Coluche candidat à la présidence de la République. Bref, une carrière bien remplie, et pas forcément dans des camps qu'on juge aujourd'hui "bons". Le tout est narré dans un style assez neutre,
peu poétique, mais qui accroche et donne envie de lire.
L'auteur ne juge pas son personnage dans le corps du texte, ou si peu. Au contraire, il le laisse agir selon son caractère - faible, ou veule, ou simplement exemplaire comme peut l'être un
fonctionnaire. Cela interroge le lecteur sur le devoir d'obéissance de l'employé de l'Etat; mais Didier Daeninckx y répond d'ores et déjà dans le titre de son roman: on l'a compris, le "salaud
ordinaire" érigé en exemple, c'est Duprest, et la lecture s'en retrouve guidée. On aurait pu suggérer une autre vision du personnage, par exemple en le présentant contre un homme mobilisé en
permanence contre la sédition. Le choix du titre suggère donc que le lecteur n'est pas assez malin pour choisir son camp tout seul: l'auteur le fait à sa place, que cela lui plaise ou non.
Aujourd'hui, il y a des gens qui rejettent l'héritage de Mai 68, et qui ne veulent rien savoir du communisme... et ce ne sont pas des salauds pour autant.
Et puis, il est assez lourd de faire peser sur le seul Clément Duprest le nom infamant de "salaud". Le lecteur trouvera en effet, dans ce roman, toute une belle brochette de salauds, pas
meilleurs que le personnage principal. A moins qu'il ne s'agisse simplement d'âmes grises qui cherchent à se faire leur trou en fonction des circonstances, dans un siècle troublé? On se souvient
par ailleurs du personnage de Labin, prof de philo soixante-huitard et pédophile, coffré par Duprest: pour l'auteur, c'est une manière de faire se confronter deux points de vue sur ce type de
délit. En s'élevant là contre, Duprest est-il encore un salaud, vraiment? La perception de la pédophilie a du reste fortement changé entre Mai 68 et aujourd'hui, à la suite notamment de
l'affaire Dutroux. Comment percevoir l'approche de l'auteur? En se mettant du côté du salaud... ou du pédéraste libertaire?
Un autre élément me chiffonne également dans ce roman. C'est l'approche très "carte postale" du Paris des années 1940 à 1980. On y croise les célébrités à la pelle, d'Arletty à Jean-Paul Sartre
en passant par Yves Montand et même Serge Gainsbourg - à croire qu'à Paris, il suffit de sortir pour croiser toutes les stars que la France a portées. Un concentré peu réaliste... L'autre élément
qui fait "carte postale" est la mise en évidence d'objets emblématiques de leur époque, à titre d'effet de réel - un peu trop, déjà, pour faire vrai. Il n'est pas facile, par ailleurs, de parler
de la France occupée (et des Nazis) après que tant d'autres l'ont fait, souvent avec brio. Cependant, tout cela repose sur une abondante documentation, dont l'auteur fait part en fin de
volume.
L'auteur comprendra malgré tout que j'ai passé de bons moments en compagnie de son livre. Des moments qui font réfléchir - c'est déjà beaucoup, et je l'en remercie. A mon avis, ce n'est pas son
meilleur ouvrage; mais je le retrouverai avec plaisir dans un bon petit polar... éventuellement un Poulpe?
Didier Daeninckx, Itinéraire d'un salaud ordinaire, Paris, Gallimard/Folio, 2007.



 Il est des ouvrages que
l'on trouve tout par hasard, un peu comme si l'on venait d'ouvrir une pochette surprise: peu
Il est des ouvrages que
l'on trouve tout par hasard, un peu comme si l'on venait d'ouvrir une pochette surprise: peu





