 Défi Frédéric Dard, lu par Didi, Mazel, Thierry Gagnon, Tilly - lecture commune, jusqu'au 26
décembre!
Défi Frédéric Dard, lu par Didi, Mazel, Thierry Gagnon, Tilly - lecture commune, jusqu'au 26
décembre!
... dans l'eau de mer avant de pédaler dans la semoule au terme de deux ou trois petits tours de truanderie, en compagnie de l'ex-plagiste Lambert: voilà, en très gros, la trame de "La vieille qui marchait dans la mer" (1988), roman signé San-Antonio - un de ces ouvrages costauds où l'auteur démontre qu'il sait faire autre chose que raconter les aventures d'un commissaire coureur de jupons et d'une clique d'allumés. Cela dit, nombreux sont les parallèles qu'on peut faire entre la riche geste sanantoniesque de base et "La vieille qui marchait dans la mer".
Ainsi retrouve-t-on ici, sans surprise, la veine gauloise qui a fait la fortune de l'auteur. Mais là, les p'tites pépées cèdent la place à Lady M., une octogénaire excentrique dont le fonds de commerce est l'escroquerie de haut vol, en collaboration avec un ancien diplomate roumain lubrique, Pompilius Senaresco, dont le patronyme évoque de loin la sénescence. Lady M. prend sous son aile un jeune plagiste (25 ans) dénommé Lambert et décide de lui enseigner le métier d'escroc. Ainsi se met en place une dynamique complexe entre deux aïeux qui ont leurs idées et un jeune homme qui a les siennes et fonctionne comme un grain de sable intergénérationnel dans le couple. Curieusement, ce n'est justement pas le jeune homme qui est le plus actif sexuellement; il fonctionne plutôt comme un repoussoir blasé (l'adorable Noémie Fargesse, avec laquelle la communication s'avère impossible, en sait quelque chose, de même que l'Alexandra du début, rejetée sans ménagement comme un détritus), alors que Pompilius prend tout ce qui se présente et que Lady M., eh bien... retenons, pour ne pas trop en dire, qu'elle oscille entre le rêve et la réalité.
Les lecteurs avertis de San-Antonio reconnaîtront par ailleurs, dans la description faite de New York dans "La vieille qui marchait dans la mer", quelques traits utilisés dans "Circulez, y'a rien à voir", excellent titre de la série régulière, quasi contemporain (1987), qui se déroule également dans la Grosse Pomme - en particulier l'idée de la librairie française qui rétrécit à vue d'oeil, symbole de la perte de rayonnement d'une certaine France, ou la fascination que la grande ville exerce, à l'instar de Venise. Cela, sans oublier la question du sida, qui affleure çà et là dans "La vieille qui marchait dans la mer" et constitue le socle de l'intrigue de "Circulez, y'a rien à voir". Enfin, d'une manière plus générale, Senaresco ne fait-il pas un peu penser à Pinaud?
Le double point fort de ce récit réside dans la représentation de personnages à la fois improbables à force d'être baroques et caricaturaux (en particulier les deux aînés) et profondément travaillés - à l'instar des dialogues, où fusent volontiers des insultes et noms d'oiseaux aux allures d'oxymores délirantes. Au gré des pages, en particulier, Lady M. devient familière au lecteur, avec ses prénoms réels ou inventés et ses mille et une aventures masculines. Comme le suggère son prénom, Pompilius Senaresco est des plus pittoresques - au risque de faire passer Lambert pour un gamin finalement insipide. Reste que l'image de ce dernier est également bien dépeinte, indirectement, en particulier dans le cadre des dialogues intérieurs que Lady M. entretient avec Dieu le Père en personne.
Parce que l'écrivain use et abuse ici d'un procédé, celui des monologues intérieurs - Lady M. avec Dieu, Lambert avec Lady M., à laquelle il ne confie pas tout à voix haute. Omniprésente, cette manière confère toutefois à ce roman une certaine lourdeur et des longueurs; en particulier, l'histoire du viol originel de Lady M. apparaît deux fois sans que cela se justifie d'emblée - l'auteur épargnant de justesse au lecteur l'affront d'une troisième narration, ouf! Ces longues stances empêchent par ailleurs l'action et les entourloupes de se multiplier - une belle occasion manquée, vu le dynamisme dont Lady M. fait preuve en dépit de son emblématique canne et de âge canonique.
La principale vertu qu'on peut trouver à ces monologues réside sans doute dans un exercice de grand écart: femme extravagante et dépourvue de scrupules, Lady M. s'adresse à Dieu en jouant la séduction et la familiarité, alternant beau parler et verbe fleuri. Car si la langue de narration utilisée dans ce roman aux accents grinçants reste factuelle lorsqu'il s'agit de relater des faits, elle prend les chemins de la créativité échevelée dès lors qu'un moment de la narration le permet ou le suggère. C'est là, dans le sens de l'à-propos, que réside tout l'art de l'écrivain...
San-Antonio, La vieille qui marchait dans la mer, Paris, Fleuve Noir, 1988.



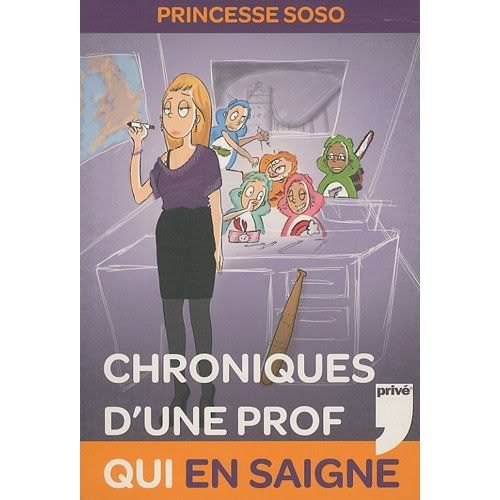
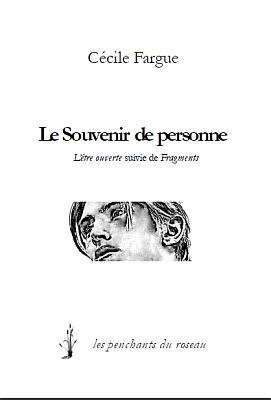
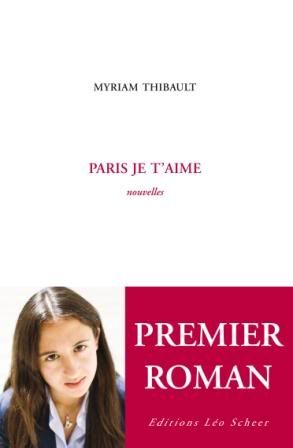
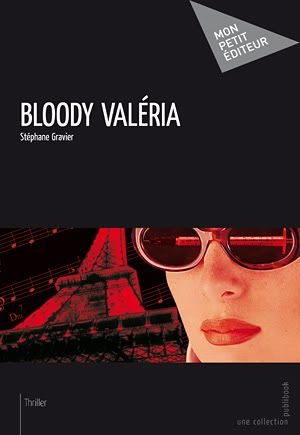

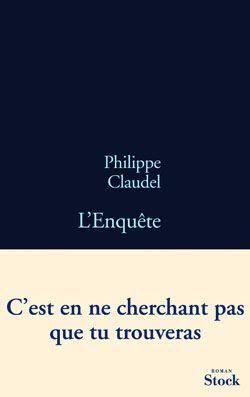

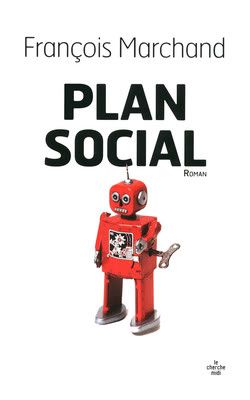
 François Marchand, Plan social, Paris, Le Cherche-Midi, 2010, 120 pages.
François Marchand, Plan social, Paris, Le Cherche-Midi, 2010, 120 pages.